Bonjour,
Je me suis beaucoup interrogé sur les questions que vous soulevez car j’ai récemment cherché à développer un projet en ligne et suis sur le point d’y renoncer faute de temps/ressources. Et j’ai eu l’occasion de me faire une opinion sur le sujet.
Je crois être ce que l’on pourrait appeler un programmeur amateur (un geek ?) – j’ai fait du C et du C++ durant mes études, quelques sites en flash « pour rendre service », j’ai appris le java et la création de webservices pour connecteur mes appli flash à une base de donnée Mysql, etc…
Bref, je ne me considère pas comme un professionnel car je ne gagne pas ma vie avec cette activité et que mes connaissances sont bien trop limitées pour garantir la viabilité d’un projet in fine…
Quoiqu’il en soit, je voulais vous faire partager ma propre expérience de porteur de projet : j’ai cherché à profiter d’un changement d’emploi pour créer un site web « relativement » original et moyennement ambitieux en termes de fonctionnalités. N’ayant pas de ressources financières et ne voulant pas faire des propositions « mensongères » à des programmeurs du genre « tu seras payé quand ça marchera » alors que le risque du projet est élevé, je me suis décidé à programmer moi-même une version prototype du site. J’ai cherché ces deux derniers mois à approfondir mes connaissances en programmation web et je dois dire que j’ai réalisé ces derniers jours à quel point il est très peu réaliste de se lancer dans une telle entreprise en raison, non pas des connaissances à acquérir, mais du temps pour mettre en place un projet à dimension « professionnel » : je m’imaginais être capable de mener à terme un projet qui fait normalement appel à une équipe d’au moins 5 personnes pendant plusieurs mois. Si je renonce à jeter l’éponge : il me faudrait au moins 6 à 9 mois pour arriver à une version non testée…
D’ailleurs, juste pour reprendre l’idée de l’article initial, le temps de développement d’un projet pour un novice serait :
1 – le temps d’identification des langages et technologies à apprendre (1 ou 2 mois ?)
2 – l’apprentissage de ces langages (de 3 à 6 mois ?)
3 – la formalisation de son projet (2 à 3 mois ?)
4 – la mise en œuvre « seul » (de 3 à 6 mois ?)
Autant dire que le type doit être rentier...
Mon « vrai » métier est la gestion financière et j’ai régulièrement travaillé avec des porteurs de projets entrepreneuriaux. Pour rebondir sur certains problèmes soulevés plus haut, on peut « normalement » positionner un projet de création dans deux cases:
- projet original et innovant (en terme technologique mais aussi d’offre)
- projet visant à l’amélioration de l’existant (l’offre existe mais elle peut être améliorée)
En termes de stratégie générale, l’idée « originale et innovante» est un concept perçu comme plus risqué pour l’investisseur. Si le projet n’a pas encore été réalisé, il peut y avoir plusieurs raisons :
- Personne n’a eu cette idée : il s’agit effectivement d’un projet innovant et prometteur qui vise à créer une nouvelle offre ou à se substituer à une offre existante (exemple par mi d’autres de ventes-privées.com qui substitue le déstockage physique local par une forme de déstockage délocalisé et « haut de gamme »)
- Ce projet est irréalisable (ou très difficilement) en terme techniques (exemple farfelu : diagnostic médical en ligne pouvant remplacer l’avis du médecin, etc… d’ailleurs certains projets sans perspectives font parfois le buzz dans les médias malgré/pour leur irréalisme - voiture volante, etc...)
- La demande pour ce projet n’existe pas ou pas encore : pour simplifier, les clients n’en verront pas vraiment l’utilité aujourd’hui.
Les start-up sont à l’inverse de la plupart des secteurs, généralement valorisée pour leur dimension innovante puisque le territoire du web est encore en friche. Pour « limiter » au maximum le risque inhérent à ces projets qui peuvent s’avérer très lucratifs, les investisseurs préfèrent effectivement investir dans des projets déjà initiés. J’ai régulièrement entendu qu’un projet de start-up devait se lancer pour moins de 100k€ - puis faire l’objet d’une levée de fond après « validation ».
En termes de stratégie pure, un projet innovant peut également avoir pour ambition d’occuper une position avantageuse (« first mover ») dans un marché qui va émerger en faisant un pari sur une technologie sur le point d’aboutir. C’est un peu le pari, certes risqué, de mon propre projet.
Contrairement à l’idée généralement admise, il est à mon sens préférable que l’idée innovante ait fait l’objet d’une première tentative plus ou moins ratée : on pourra identifier les raisons de cet échec, éviter un certain nombre d’écueils dans le meilleur des cas, ou au pire prendre conscience de l’irréalisme du projet.
A mon sens, il est peu crédible qu’un novice ou un amateur (qui ne dispose généralement pas de 100k€) puisse remplacer à lui seul un équipe de programmeur pour un projet ambitieux. A l’inverse, je pense qu’il est exceptionnel (évidemment cela existe) qu’un ou plusieurs développeurs puissent concevoir une stratégie crédible dans un secteur qu’ils connaissent mal. Je crois que c’est la raison pour laquelle il existe beaucoup de start-up visant directement des professionnels de l’informatique (souvent des grandes entreprises).
Les discours tels que celui de « l’expert des projets d’entreprise » consiste, à mon avis, à entretenir le rêve du « self-made-man » alors que ce monsieur doit bien connaître la complexité des processus mis en jeu. D’ailleurs, du point de vue de l’investisseur, ne s’agit-il pas de reporter le risque initial du projet sur le temps et l’énergie d’un individu ? Sans excès de pessimisme, je pense que les « self-made-man » sont très rares : dès que les médias en trouvent un, ils ont tendance à le placarder en Une.
A l’inverse, je pense que l’association du gestionnaire et du programmeur est beaucoup plus réaliste et a de grandes chances d’aboutir sur ces projets. Les premières réactions visant à « dénoncer » les pratiques de porteurs de projet qui promettent une rémunération après « succès » ou autre sont, à mon sens, le reflet d’une méconnaissance des uns et des autres :
- Les gestionnaires n’ont pas idée de l’énergie et du temps que demandent leur propres projets, ils peuvent même avoir tendance à relayer le programmeur au rôle de « salarié non rémunéré »
- Les informaticiens n’imaginent pas l’énergie et le temps nécessaire à promouvoir, à piloter, à convaincre dans le cadre une activité en création.
Les bons gestionnaires sont certainement aussi rares que les bons programmeurs. Mais l’évaluation d’un projet fait partie du métier du gestionnaire – si vous avez confiance dans les qualités professionnelles de cette personne, rien ne sert de porter des jugements hâtifs. Et la réciproque est vraie. La question pour réside plutôt dans la manière de se faire une opinion des qualités de cette personne et je pense qu’un informaticien ou un gestionnaire expérimentés ont tous deux cette compétence.
Les deux bords ont des intérêts communs à travailler ensemble, ce qui nécessite de connaître le travail et les préoccupations de l’autre pour pouvoir dialoguer avec lui d’égal à égal – et prendre des risques en commun.
Mais pour ce connaître, il faut d’abord se rencontrer : expliquer à l’autre et entendre ce que l’autre a à dire…et faire tomber un certain nombre de préjugés et de pratiques malheureuses.
Je pense que d’autres pays sont beaucoup plus avancés que nous dans ces échanges (notamment pendant la période des études), ce qui participe fortement au dynamisme de leurs start-up.
 15
15 |
 0
0 |
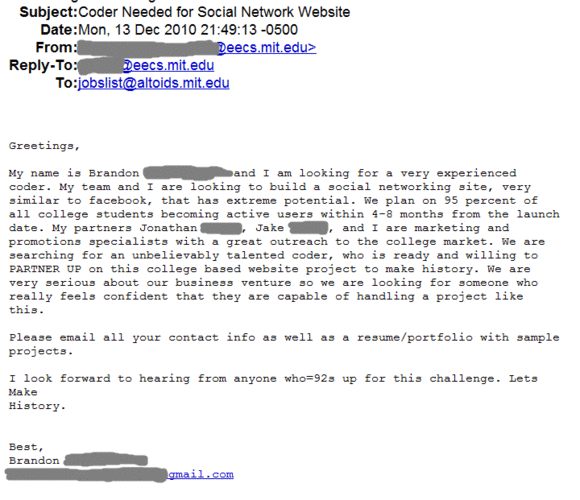
 Êtes-vous de cet avis ?
Êtes-vous de cet avis ? Et recevez-vous ce genre d'offres de « super développeurs » prêt à implémenter les idées des autres sans rémunération sûre ? Comment y répondez-vous ?
Et recevez-vous ce genre d'offres de « super développeurs » prêt à implémenter les idées des autres sans rémunération sûre ? Comment y répondez-vous ?




 avec des amis développeurs compétents
avec des amis développeurs compétents